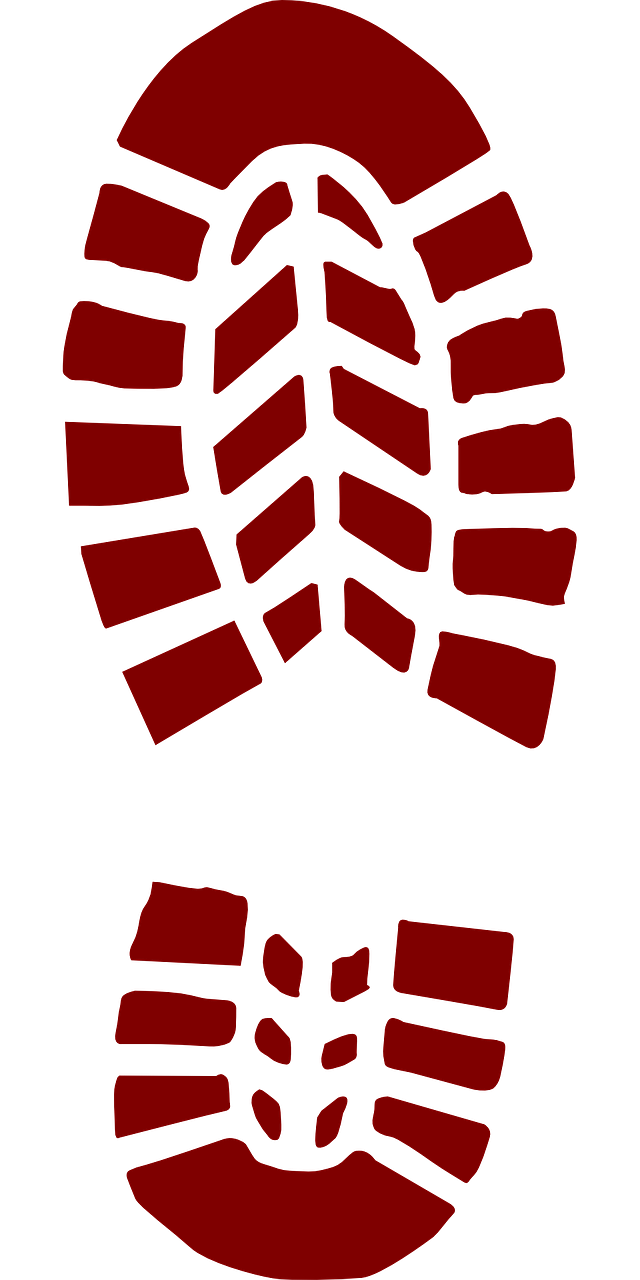|
EN BREF
|
Le CNRS avance significativement vers une transition bas carbone, initiée par un plan de transition lancé fin 2022. Ce plan nécessite un temps d’accompagnement et de sensibilisation pour engager les équipes et ancrer le changement. Plusieurs actions concrètes ont déjà été mises en place, notamment en matière de formation des agents à des pratiques écoresponsables, d’achats responsables, et de politiques favorisant la mobilité douce. Le CNRS se concentre aussi sur des initiatives d’économie d’énergie et la réduction de l’impact carbone, illustrées par des projets novateurs dans les domaines de la restauration collective et des bâtiments. Les préfets de chaque délégation encouragent des pratiques de sobriété énergétique et favorisent l’usage du vélo parmi les agents, témoignant d’un engagement fort pour l’environnement.
Le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) a mis en place un plan ambitieux visant à réduire son empreinte écologique et à atteindre une transition bas carbone. Adopter des pratiques responsables dans ses activités quotidiennes et intégrer les enjeux environnementaux dans ses projets de recherche apparaissent comme des priorités. Le CNRS se concentre sur plusieurs axes, notamment la sensibilisation des agents, l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, l’optimisation des achats et le soutien à la mobilité durable. À travers des initiatives concrètes et innovantes, cet établissement pionnier montre son engagement vers un avenir plus durable.
Sensibiliser et former : un levier essentiel
Le développement durable peut sembler abstrait pour certains, surtout lorsqu’il n’affiche pas immédiatement ses effluents positifs. C’est pourquoi le CNRS accorde une importance capitale à la sensibilisation et à la formation de ses agents. Blandine De Geyer, référente nationale en développement durable du CNRS, explique que le plan de transition exige un temps de sensibilisation et d’accompagnement. Ce processus vise à rassembler tous les collectifs de travail afin d’ancrer durablement le changement.
Depuis le lancement de ce plan, il y a plus d’un an, des dynamiques ont été mises en œuvre à l’échelle des délégations régionales. Ce travail est crucial pour susciter l’adhésion et introduire une approche globale face aux enjeux environnementaux. Ainsi, des formations spécifiques telles que l’initiative la Fresque du climat ont vu le jour pour préparer des animateurs et animatrices à mener des activités au sein du CNRS. Entre février 2023 et janvier 2024, un premier cycle a permis d’initier une dizaine d’agents, renforçant le vivier de fresqueurs et fresqueuses au sein de l’organisme.
Achats écoresponsables : réduire l’impact carbone
Un autre objectif majeur de la transition bas carbone du CNRS est l’optimisation des achats, qui représentent 74 % de l’impact carbone selon le bilan établi en 2019. Le CNRS a donc décidé de se tourner vers des pratiques écoresponsables, incitant à « acheter moins pour acheter mieux ». Dans cette voie, une instruction sur les achats écoresponsables a été mise en place, obligeant les acheteurs de tout le réseau à intégrer des critères environnementaux dans leurs marchés à partir de juin 2023.
Ce projet bien plus qu’un simple cadre réglementaire, se veut un véritable engagement à long terme. La direction déléguée aux achats et à l’innovation, dirigée par Sébastien Turci, a constitué un groupe de travail pour établir des critères d’achat selon les différents segments. Cette liste permet aux acheteurs de demander des engagements concrets à leurs fournisseurs en matière d’emballage, de transport, de recyclabilité et de réparation du matériel, favorisant ainsi des choix éclairés et responsables.
Restauration : un secteur innovant et écoresponsable
Le CNRS s’emploie également à repenser ses pratiques au sein de la restauration collective, un domaine où l’impact environnemental est souvent sous-estimé. La délégation Occitanie Ouest, par exemple, entame des expérimentations dès 2025 après le renouvellement de son marché. Les critères sociaux et environnementaux vont être intégrés dans l’évaluation des fournisseurs, pesant jusqu’à 20 % dans les décisions.
À titre d’exemple, la délégation toulousaine prévoit de réduire la diversité des offres alimentaires au profit de la qualité, en favorisant des produits sains issus de l’agriculture biologique et en circuit court. Les invendus seront soit revendus aux agents soit donnés à des associations, ce qui illustre bien une démarche responsable face au gaspillage alimentaire.
Efficacité énergétique des bâtiments
Les consommations énergétiques des bâtiments du CNRS constituent un enjeu significatif, représentant presque 15 % des émissions de gaz à effet de serre. Pour réduire cet impact, le CNRS a entrepris des travaux d’isolation et/ou d’autres améliorations structurelles, qui se traduisent déjà par des résultats tangibles. Par exemple, le Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes a considérablement réduit sa consommation d’énergie en améliorant ses installations.
Des dispositifs tels que des panneaux photovoltaïques, des systèmes de récupération de chaleur et des registres modulants ont permis d’atteindre des baisses de consommation allant jusqu’à 80 % pour le gaz. De plus, des réseaux de techniciens et de référents développement durable favorisent le partage de bonnes pratiques en matière de = « sobriété énergétique » ?>.
Mobilité durable : incitation à l’usage du vélo
La promotion des mobilités douces, notamment du vélo, s’inscrit également dans la démarche des CNRS pour réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail. Avec environ 87 % des déplacements professionnels ayant recours à des voitures thermiques, une politique nationale a été mise en place pour encourager des pratiques plus respectueuses de l’environnement.
Le challenge « Mai à vélo », prévu pour mai 2024, se veut une action phare pour mobiliser les agents autour de l’usage du vélo. En Alsace, par exemple, les résultats des défis précédents témoignent d’une forte implication des agents corporatifs autour de la pratique cycliste, avec plus de 45 000 km parcourus en 2023.
Le CNRS souhaite pérenniser cette dynamique en mettant à disposition des infrastructures adaptées, comme des places de stationnement pour vélos, sur 75 % de ses sites d’ici 2027. Dans cette optique, le taux d’agents bénéficiaires du forfait mobilités durables doit passer de 10 % à 20 % dans les prochaines années.
Suivi et évaluation des résultats
Pour garantir l’efficacité de ses initiatives, le CNRS a réalisé des bilans réguliers des émissions de gaz à effet de serre pour évaluer les progrès réalisés et les ajustements nécessaires. Le premier bilan effectué en 2022 a posé les bases d’un suivi rigoureux de la transition bas carbone. Ce retour d’informations est essentiel pour orienter les actions futures et garantir la pertinence des efforts engagés.
Dans cette optique, des groupes de travail comme le LMI (Laboratoire de la Mobilité et de l’Innovation) jouent un rôle crucial. Ils permettent d’évaluer l’impact des différentes initiatives et de développer des recommandations pour renforcer l’efficacité des actions entreprises.
Des projets variés et innovants
Le CNRS ne se limite pas à ses objectifs internes. Il s’implique aussi dans des projets de recherche plus larges qui mettent en avant la biodiversité et l’innovation durable. Des laboratoires tels que celui de Morphodynamique continentale et côtière visent à planter des mini-forêts de 400 m² pour favoriser la ressource écologique.
Ces projets illustrent bien la capacité du CNRS à fédérer les acteurs scientifiques et citoyens autour de l’importance de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique. Au-delà du cadre normatif, ce type d’initiatives vise à élever la conscience collective en matière de développement durable.
Vers un avenir écoresponsable
Les actions du CNRS incitent à espérer un Futur plus durable, au travers d’une approche intégrée et sérieuse des questions environnementales. Chaque pas fait par l’institut représente une avancée vers une transition bas carbone non seulement souhaitée mais nécessaire. L’ensemble des agents, chercheurs, et partenaires sont invités à collaborer dans ce sens, car ensemble, ils peuvent démontrer qu’il est possible de s’engager dans un changement systémique.
Le CNRS se retrouve à la pointe de cette évolution, assurant un leadership exemplaire dans la recherche scientifique, tout en prenant en compte les enjeux de son empreinte écologique. Les avancées réalisées à ce jour témoignent d’un potentiel d’évolution qui, si mobilisé de façon cohérente, pourrait entraîner une réelle transformation des pratiques dans le paysage scientifique et au-delà.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les ressources accessibles concernant le plan de transition bas carbone du CNRS, le deuxième bilan carbone du CNRS ainsi que les divers projets écoresponsables à travers des liens pertinents ici et là.

Blandine De Geyer, référente nationale développement durable du CNRS, souligne le caractère paradoxal du développement durable : « Ce n’est pas toujours visible immédiatement ». En effet, elle explique que la mise en place d’un plan de transition requiert un temps d’accompagnement pour impliquer pleinement tous les collectifs de travail. Cependant, elle observe que, plus d’un an après le lancement du plan de transition, des dynamiques positives se forment à travers les différentes délégations régionales.
Patrice Guyomar, référent développement durable de la délégation Occitanie Est, insiste sur l’importance de la sensibilisation et de la formation. Avec sa collègue, Fanny Verhille, ils ont mis en place un cycle de formation pour initier des animateurs à la Fresque du climat. « Il fallait jongler entre l’urgence d’agir et la nécessité d’un plan d’actions structuré », confie-t-il. Malgré des appréhensions, Fanny Verhille assure que même une petite implication dans cette mission peut avoir un impact significatif sur le changement.
The direction déléguée aux achats et à l’innovation (DDAI) a également pris de mesures en faveur d’achats écoresponsables. Son directeur, Sébastien Turci, rappelle que « acheter mieux ne signifie pas acheter plus ». Dès mai 2023, une instruction a été publiée pour intégrer des critères environnementaux dans les marchés, ce qui constitue un pas vers des pratiques plus durables.
Virginie Mahdi, déléguée régionale adjointe de la délégation Occitanie Ouest, souligne la restauration collective comme un champ d’expérimentation RSE. À partir de 2025, des critères sociaux et environnementaux plus rigoureux seront appliqués lors de l’évaluation des fournisseurs. Elle affirme : « Nous souhaitons prioriser la qualité des produits, en mettant fin à la diversité excessive de l’offre », afin de diminuer les déchets et favoriser les circuits courts.
Anthony Venier, acheteur à la délégation Paris-Normandie, observe également que la gestion des déchets en restauration a un impact significatif. « Nous cherchons à maintenir un marché attrayant pour les prestataires tout en intégrant les enjeux environnementaux », explique-t-il. Les difficultés économiques de ce secteur rendent la tâche complexe, mais chaque initiative prise est un pas vers une alimentation plus durable.
Concernant la consommation d’énergie, le CNRS a réussi à réduire de près de 8 % sa consommation en un an. Cette avancée, selon Jérôme Dupuis, responsable des projets d’énergie, est due en grande partie aux efforts d’isolation et d’amélioration énergétique des bâtiments. « L’intégration de systèmes plus efficaces a un double effet : nous réduisons nos dépenses tout en atteignant nos objectifs de durabilité », conclut-il.
Enfin, pour favoriser le mouvement vers des solutions de transport durables, Julie Quillé met en avant l’initiative du challenge « Mai à vélo ». « En encourageant nos agents à privilégier le vélo, nous diminuons nos émissions de CO2 et favorisons la santé de nos équipes », affirme-t-elle tout en exprimant sa volonté de pérenniser cette pratique au sein du CNRS.